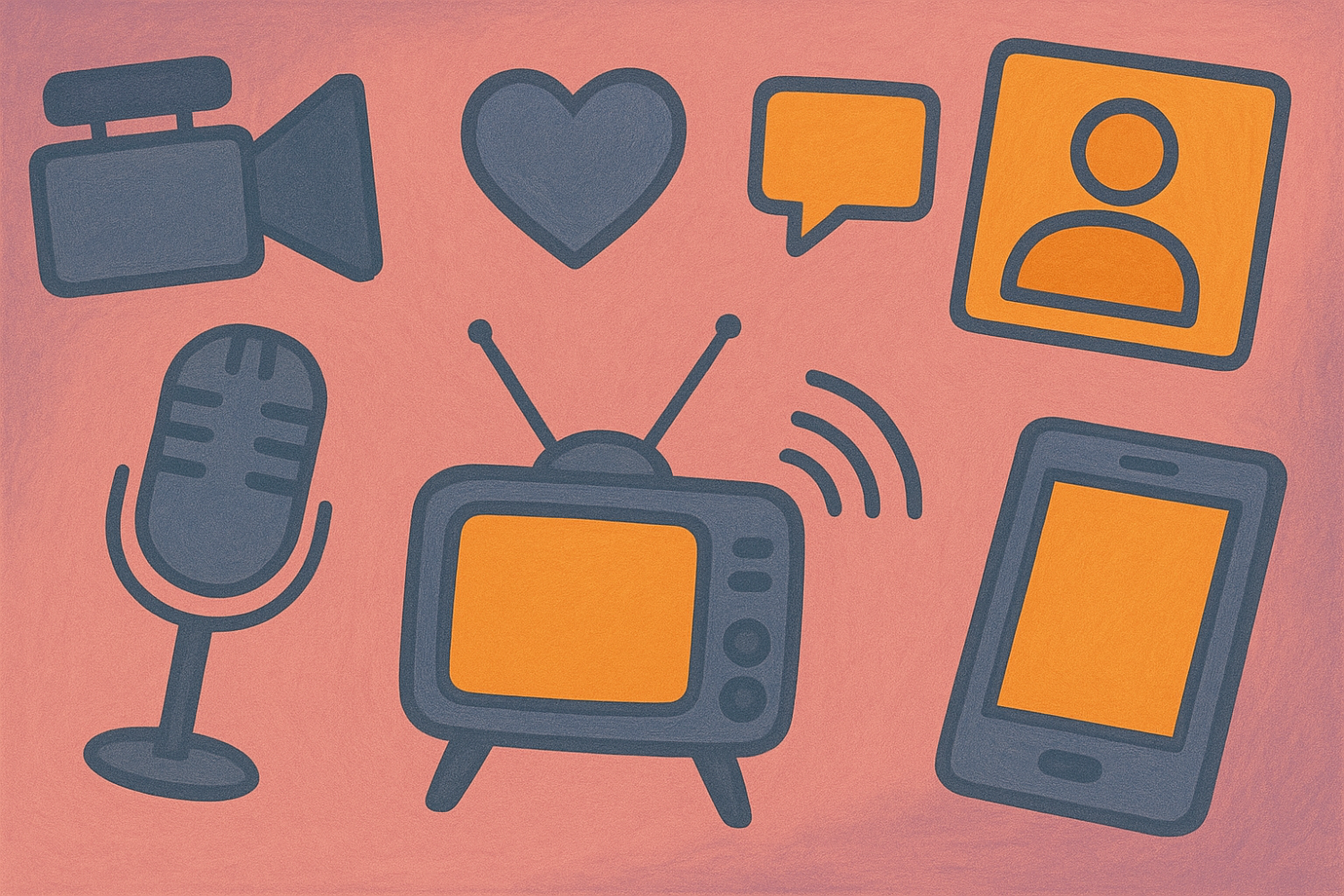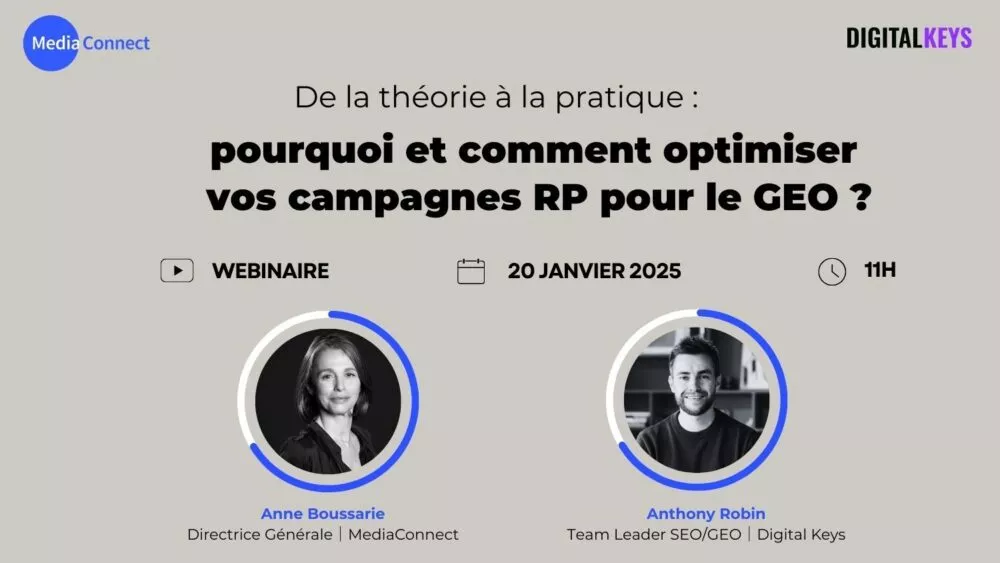Si ces créateurs rencontrent leur public, c’est aussi parce qu’ils répondent à une attente, occupent un espace laissé vacant, dans un contexte où par ailleurs, « seulement 32 % des Français estiment que l’on peut avoir confiance dans ce que disent les médias sur les grands sujets d’actualité», rappelle Guillaume Caline, directeur Enjeux publics et opinion chez Verian. De quoi compliquer un peu plus la tâche des rédactions dans leur conquête des plus jeunes. « Hugo Décrypte atteint désormais un niveau de couverture comparable, voire supérieur, à celui de nombreux médias traditionnels, si l’on se réfère au dernier rapport du Reuters Institute », souligne Alexandra Klinnik, journaliste innovation média chez Méta-Media, le blog collectif de France Télévisions.
Un succès évidemment porté par l’évolution des usages, qui voient l’information consommée sur smartphone, via des formats plus courts, directs et incarnés. Pourtant, cette montée divise : 53 % des Français jugent problématique que, grâce aux réseaux sociaux, de plus en plus de non-journalistes diffusent de l’information en lien avec l’actualité. Chez les moins de 35 ans, ils sont 51 % à penser l’inverse (étude 2024 Verian - La Croix - La Poste). « Il y a un clivage générationnel très net. Les jeunes sont plus friands de ces nouvelles voix. Reste à voir si cela durera », relève Guillaume Caline, également sociologue.
S’inspirer pour reconquérir les audiences
Face à ces nouveaux visages de l’info, les rédactions n’ont eu d’autres choix que de s’adapter. « Ces déplacements d’audience poussent les médias traditionnels à intégrer ces formats et à s’en inspirer », constate Guillaume Caline. « On ne peut plus ignorer l’impact de ces créateurs, abonde Alexandra Klinnik. Ils savent capter l’attention et rendre l’information accessible, s’inspirer de leurs codes n’a rien de dégradant. »Certaines initiatives concrètes traduisent cette volonté de mutation : l’émission méta-Talk, lancée par Méta-Media et diffusée sur Twitch, capte des publics difficiles à toucher. L’arrivée du créateur Gaspard G sur France Inter ou la diffusion des interviews d’Hugo Décrypte sur France Télévisions témoignent d’un rapprochement assumé avec ces logiques communautaires et ces formats plus directs.
Pour Alexandra Klinnik, ces partenariats ne suffisent pas : « Les journalistes doivent créer un sentiment d’appartenance. Toute personne doit sentir que son identité est reflétée : femmes, jeunes, classes socio-économiques défavorisées… Ce sont souvent eux qui décrochent de l’actu. Il ne faut pas seulement regarder les clics ou la durée de lecture, mais comprendre leurs routines, leurs priorités, ce qui compte pour eux au quotidien. »
« Les médias qui n’investissent pas ces espaces et ne définissent pas d’angle clair risquent de perdre la bataille de l’attention », estime quant à lui Antonin Marin, cofondateur du « Crayon », chaîne dédiée au débat suivie par plus d’un million de personnes sur les réseaux sociaux. « Je pense pas du tout qu’ils ont perdu cette bataille, nuance Charlotte Vautier. Les jeunes s’informent sur Internet, mais les médias traditionnels y sont aussi, avec plus ou moins les nouveaux codes. »
Des codes caractérisés par une plus grande liberté. Sur sa chaîne « OK Charlotte », les formats de la vidéaste sont portés par l’humour, la narration directe, une caméra tenue à bout de bras façon vlog « Il y a plus de sincérité sur YouTube : plus de coulisses, plus de temps, plus de flexibilité, et surtout un retour immédiat du public. Ce qui me semble moins déconnecté ».
Former la relève aux nouveaux formats
Certaines écoles de journalisme empruntent déjà ce virage. « Nos étudiants manifestent un intérêt croissant pour ces nouvelles écritures », observe Stéphanie Lebrun, directrice du Centre de Formation des Journalistes (CFJ). L’école a d’ailleurs lancé un parcours « nouvelles écritures visuelles » pour permettre à ses étudiants d’apprendre à produire des formats conçus pour les réseaux sociaux.« Aujourd’hui, un reportage ne vit plus seul. Il doit exister ailleurs : extraits courts, reels, déclinaisons… Un même sujet peut vivre sur plusieurs supports. Cela demande de la polyvalence, mais aussi de la rigueur », insiste Stéphanie Lebrun. Mais selon elle cette hybridation ne remplace pas le socle pour autant : « Les bases du métier restent les mêmes : chercher l’info, vérifier, hiérarchiser. Sans cela, on ne tient pas la promesse d'une information certifiée. »
Si quelques diplômés font le choix de l’indépendance, la majorité vise encore des rédactions classiques ayant pris le virage numérique, du service vidéo du Monde, au pure player Konbini, en passant par les nouveaux formats chez France Télévisions. « La différence se joue sur la capacité à maîtriser ces codes sans renoncer aux fondamentaux », souligne la directrice d’école, également dirigeante de la société de production de documentaires Babel Doc.
Charlotte Vautier revendique la même exigence sur YouTube : « Il y a autant, voire plus, d’infos et d’immersion que dans un reportage classique. La différence, c’est la forme, qui sera plus incarnée, plus spontanée. »
S’adapter sans brouiller les repères
Mais cette adaptation n’est pas sans risque. « Contrairement aux journalistes, beaucoup de créateurs évoluent sans cadre déontologique ni processus de vérification », prévient Alexandra Klinnik, qui cite une étude de l’UNESCO (Behind the Screens, 2024) selon laquelle 62 % des créateurs interrogés reconnaissent ne pas toujours vérifier la véracité de ce qu’ils publient.Dans ce contexte, les cofondateurs du « Crayon », créateurs de contenu, viennent d’annoncer leur partenariat avec l’ESJ Paris, pour rapprocher formation et pratiques des créateurs. Racheté en novembre 2024 par un consortium d'investisseurs regroupant Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Rodolphe Saadé et Pierre-Edouard Stérin, l’établissement, non reconnu par la profession journalistique, a fait savoir sa volonté d’« avancer sur les nouvelles façons de donner une information claire et juste dans les réseaux sociaux ».
Guillaume Caline résume ainsi l’équilibre à trouver : « Les médias doivent rester visibles et accessibles sans brouiller les repères. Sur les réseaux, journalistes et créateurs apparaissent parfois au même niveau, rendant le paysage plus flou pour le public, qui doit pouvoir distinguer le travail journalistique de l’opinion brute. »