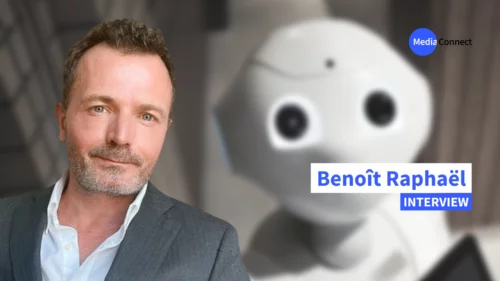Le phénomène des fausses informations revêt une importance particulière à l'ère du numérique. Concrètement, qu’en est-il aujourd’hui ?
Ce n’est pas un secret : depuis un certain nombre d’années, portées par l’explosion des réseaux sociaux et la transformation des usages, les fausses informations viennent polluer l’écosystème de l’information. On pourrait même parler plus largement de manipulation d’informations - car aux fausses informations s’ajoutent les informations manipulées, à moitié fausses, les informations trompeuses, biaisées… Bien qu’elles aient toujours existé, les fausses informations ont vraiment pris une place considérable. Des personnes qui, autrefois, voulaient diffuser des fausses informations ne pouvaient compter que sur des publications confidentielles, des photocopies… Aujourd’hui, avec l’ubiquité des réseaux sociaux, elles peuvent avoir rapidement une audience assez large.
Néanmoins, il est extrêmement difficile d’estimer la proportion des fausses informations compte tenu de l’extraordinaire puissance des plateformes. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, Snapchat, les messageries privées… Plusieurs milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux dans le monde. Les fausses informations sont partout et suivent le rythme de l’actualité. Plus l’actualité est brûlante, plus elles sont nombreuses.
Pourquoi l’Agence France-Presse a-t-elle décidé de se lancer dans le fact-checking ?
Notre mission, depuis toujours, est de diffuser une information vérifiée. Finalement, on pourrait s’étonner que l’AFP fasse du fact-checking – de la vérification des faits – en se disant qu’il s’agit de l’essence-même et de la promesse de l’AFP vis-à-vis de ses clients. Il y a une explication à ça. Evidemment, l’AFP vérifiait les faits avant, mais, jusqu’à une époque récente, elle ne parlait pas des rumeurs et des fausses informations.
2016 a été une année charnière pour l’AFP mais aussi pour tous les médias. Dans deux scrutins majeurs - le Brexit au Royaume-Uni et l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis -, les fausses informations ont joué un rôle. Ce constat de l’importance prise par les fausses informations dans le débat public a porté l’AFP à agir. Aujourd’hui, quand on est une agence de presse moderne, quand le faux devient pratiquement autant voire plus consommé que le vrai, on ne peut pas rester les bras croisés. On a jugé, comme d’autres évidemment – nous ne sommes pas forcément les pionniers en la matière - qu’il fallait s’attacher à travailler sur les fausses informations et expliquer pourquoi elles étaient fausses, partiellement fausses ou détournées.
Comment le fact-checking est-il mis en place par l’AFP ?
Souvent, un événement conduit à lancer un projet. Pour l’AFP, cet événement a été les élections présidentielles en France en 2017. On s’est lancé dans l’investigation numérique avec un seul journaliste. Aujourd’hui, nous sommes 130, répartis dans une trentaine de bureaux dans le monde entier. Les journalistes fact-checking de l’AFP sont présents sur tous les continents : aux Etats-Unis, en Argentine, en Afrique du Sud, en Thaïlande, en Australie, en Allemagne… On travaille en 24 langues, des langues les plus évidentes comme le français, l’anglais, l’arabe, à des langues non pas plus confidentielles, parce que parfois elles sont plus parlées que le français, mais moins évidentes comme par exemple le thaï, le birman, le slovaque, le finnois, le catalan… Aujourd’hui, l’AFP est le média qui a le plus grand réseau mondial de fact-checkers.
Vous parlez d’ « investigation numérique » et non pas seulement de fact-checking. Quelle est la différence ?
Au-delà du fact-checking, au sein de l’AFP, on fait de l’investigation numérique, qui correspond à des enquêtes sur le numérique. Aujourd’hui, quand on entend couvrir l’actualité de manière exhaustive, la plus juste et la plus précise possible, on ne peut plus être uniquement sur le terrain physique. On se doit d’être présent également sur le terrain virtuel. Par exemple, depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 900 fact-checks ont été publiés par notre cellule spécialisée avec l’appui des journalistes de l’AFP sur le terrain. Finalement, le fact-checking n’est qu’une branche de l’investigation numérique. Toutes les méthodes que nos journalistes ont pour trier le vrai du faux sont des techniques d’investigation en ligne : savoir vérifier la provenance d’une photo, d’une vidéo, savoir rechercher dans le temps, retrouver les anciennes versions d’un site web... Ces méthodes d’investigation peuvent tout à fait servir plus globalement dans un journalisme de tous les jours qui n’est pas là pour démonter le faux mais qui est là pour relater le vrai.
Dans ce flot de fausses informations, comment choisissez-vous les contenus à vérifier ?
Un journaliste a un domaine d’expertise : l’économie, la politique, le sport… Il ne peut pas tout traiter, il doit faire des choix. De la même manière, face à la diffusion des fausses informations, on ne peut pas vérifier tous les sujets qui mériteraient un fact-check. On doit faire des choix. Deux critères sont pour moi primordiaux dans le fact-checking. Le premier : est-ce que le contenu est viral ? Si une fausse information est partagée par trois personnes, on ne va pas lui donner une visibilité qu’elle n’a pas. La viralité est importante mais elle n’est pas non plus absolue. Parfois, on perçoit un signal faible, c’est-à-dire un contenu qui n’est pas encore viral, mais qui mérite une vérification afin d’éviter qu’il ne le devienne. Le second point important est le type d’informations. Une grande multitude de fausses informations existe. Le grand classique ? Les fausses informations massivement partagées mais qui sont relativement inoffensives, par exemple pendant la crise sanitaire, quand les internautes s’amusaient à dire que les Simpson avaient prévu le COVID-19 des années plus tôt. C’est faux. D’autres fausses informations, en revanche, peuvent se révéler plus dangereuses tout en ne faisant qu’une centaine de partages. Mais, justement parce qu’ils peuvent être dangereux, c’est intéressant de fact-checker ces contenus. Les fausses informations sont plus ou moins graves et peuvent avoir plus ou moins des conséquences dans la vie réelle. Notre choix va avant tout être déterminé par la viralité du contenu, s’il présente un danger pour les individus ou s’il vient pourrir le débat public.
Vous précisez que ces « méthodes d’investigation peuvent servir dans un journalisme de tous les jours ». Quelle incidence le fact-checking a-t-il sur le travail des journalistes ?
Le fact-checking initie des changements. Souvent, les journalistes ont l’illusion de connaitre le numérique. Ce n’est qu’une illusion. Peu d’entre eux le maîtrisent vraiment. Les journalistes ont un compte Twitter, Facebook ou Instagram, mais on se rend compte qu’ils ne savent pas chercher efficacement sur un moteur de recherche. Sur Google, on peut faire des recherches extrêmement précises : définir des bornes chronologiques, remonter des résultats selon le type de fichier, bannir un mot de la requête… Ces fonctionnalités, 90% des journalistes ignorent qu'elles existent. C'est pourquoi nous organisons des formations en interne, au sein de l’AFP, mais également en dehors, pour enseigner les techniques de recherche, notamment les différents filtres. Ces méthodes permettent de gagner du temps et de trouver des contenus plus pertinents. Dans ce sens-là, les techniques d’investigation numérique qu’on a développées au fact-checking peuvent être utiles au reste de la rédaction.
On constate une démultiplication des fausses informations avec l’avènement des réseaux sociaux. S’ils contribuent à propager les fausses informations, peuvent-ils aussi être utiles dans la lutte contre la désinformation ?
Aujourd’hui, les réseaux sociaux ont conscience que les fausses informations pourrissent leur écosystème. Si les plateformes réagissent à des degrés divers, elles ont toutes compris qu’elles avaient besoin des journalistes pour produire du fact-checking. Nous, si on entend combattre la désinformation qui se répand sur les plateformes, il faut qu’on y soit aussi. C’est pour cela qu’aujourd’hui l’AFP collabore avec Meta dans un programme qui s’appelle le Third-Party Fact-Checking, comme plus de 60 autres médias dans le monde. Le fonctionnement est le suivant : si on détecte une fausse information sur Facebook, on va écrire notre fact-check ; la plateforme va nous mettre un outil à disposition pour marquer cette publication. L’internaute qui a partagé la fausse information, l’a rediffusée ou la voit défiler dans son flux d’actualité, va voir un avertissement avec un lien qui va conduire vers notre vérification. Ce programme avec Facebook permet également d’agir sur la viralité de ces contenus. Le propre de la fausse information, c’est qu’elle est extrêmement virale. A partir du moment où nous détectons une publication qui véhicule une fausse information, l’algorithme de Facebook va cesser de lui donner de la visibilité. Une page qui diffuse à plusieurs reprises des fausses informations va au fil du temps avoir des sanctions, c’est-à-dire moins de visibilité, l’impossibilité de faire de la publicité, voire l’exclusion de la plateforme. L’effet est réel.
Aujourd’hui, certains veulent désormais « fact-checker les fact-checkers » : comment percevez-vous cela ?
En général, les personnes qui veulent fact-checker les fact-checkers estiment que notre vérification n’est pas convaincante. Libre à eux de nous fact-checker à nouveau. Mais ce n’est pas tant l’AFP qu’il faut fact-checker, mais plutôt les experts à qui nous donnons la parole. Je ne dis pas qu’on est parfaits. On peut faire, comme n’importe quel journaliste, des erreurs, mais auquel cas on se corrige. Si vous allez sur le blog Factuel, nous avons une page avec toutes nos corrections, qui sont compilées, en toute transparence.
L’AFP lance une formation en ligne pour aider tous les journalistes à parfaire leurs compétences en matière d’investigation numérique et de lutte contre la désinformation. Retrouvez les formations ici.
Propos recueillis par Emma Alcaraz.