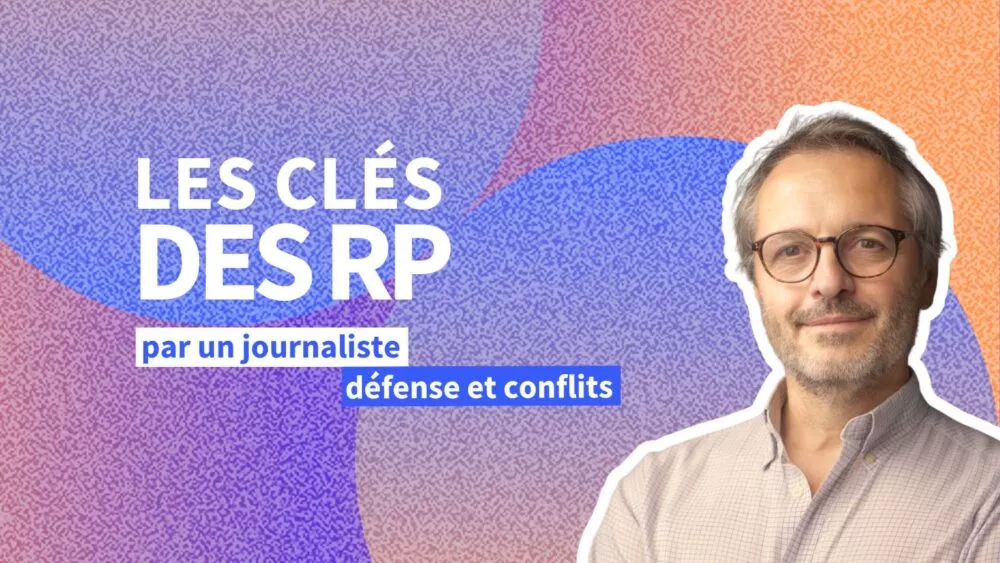Un bon sujet, même si cela peut paraitre évident, c’est un sujet d’intérêt public. Au Parisien, on dit qu’il doit être concernant, c’est à dire que les lecteurs puissent se sentir concernés d’une façon ou d’une autre. La thématique de la santé est assez pratique, car dès qu’on parle d’épidémie, de médicaments, etc., c'est tout de suite le cas.
Par ailleurs, au Parisien, nous traitons des histoires singulières et inédites. Celles qui font réagir les lecteurs, les incitent à commenter ou à partager. Il peut s’agir, par exemple, d’un témoignage marquant de guérison, d’une avancée médicale majeure ou d’une prouesse technologique remarquable.
Enfin, il y a ce que je considère comme des « passages obligés », par exemple les grandes annonces ministérielles. Notre travail, c’est de raconter ce qui peut impacter la vie des gens et leur quotidien. Par conséquent, on a toujours le lecteur en tête.
Pour que l’information d’une entreprise soit reprise dans un article, il faut qu'elle soit ancrée dans l'actualité. Cet élément me parait capital : il faut une accroche liée à l’actualité, surtout dans un quotidien comme Le Parisien.
Il y a aussi des enjeux internes dont les communicants n’ont pas forcément conscience comme des questions éditoriales et de hiérarchie de l’information. On essaye par exemple de varier les sujets.
Quelles sont vos principales sources d'information pour rédiger vos articles ?
Mes sources d'informations sont nombreuses et variées.
Tout d’abord, j’ai un réseau de sources composé de médecins, de soignants, de patients, d'avocats, de responsables d'hôpitaux ou encore de syndiqués. Nous restons en contact régulier, et ils nous alertent lorsqu’ils disposent d’informations pertinentes.
Par ailleurs, il y a ce que j’appelle les sources institutionnelles : les ministères ou les grandes agences de santé. Elles publient des rapports ou des alertes, et savent que si c’est possible, on aime bien être prévenu un peu en avance sous embargo pour avoir le temps de préparer un sujet.
Enfin, je peux être inspiré par des informations que je vois passer sur les réseaux sociaux ou dans des articles de la concurrence, notamment de la presse étrangère.
Que représentent les RP pour vous dans votre quotidien ?
Ma boîte mail déborde au quotidien. Je reçois à peu près une centaine de mails par jour, envoyés par des services de presse et agence de communication. Il m'est donc impossible de répondre à tous ces messages. Néanmoins, je les vois tous passer, et je prends le temps d’arbitrer ce qui peut m’intéresser ou non. Tant que ce sont des sujets santé, ça peut être une source d’inspiration pour moi.
Les relations presse vont, à mon sens, dans les deux sens. Je vais parfois solliciter les services de communication et de presse pour des confirmations, des demandes de précisions, d’informations sous embargo, etc. Quand on est journaliste dans un quotidien, ça fait partie du job.
Cependant, les sujets qui m’intéressent le plus sont ceux que je lance moi-même. Les mails que je reçois deviennent rarement des articles. Les messages des communicants me servent davantage d’alerte ou de source d’inspiration. Parfois le mail reçu ne me sera utile que deux semaines plus tard. Donc je vois tout passer, et ça reste toujours dans un coin de ma tête.
Est-ce que vous parleriez plutôt de travail d'équipe, ou de rapport de force ?
J'aurais du mal à parler de travail d'équipe, parce que je considère qu'on fait deux métiers très différents, même quasiment contradictoires. Quelque part, ils sont là pour vendre des sujets. Moi, je suis là pour écrire des articles que je trouve intéressants et pas pour acheter des sujets qu'on me donne tout prêts sur un plateau. Je vois plutôt les relations presse comme un rapport de force, mais pas au sens péjoratif du terme. On peut tout de même bien travailler ensemble.
Finalement, les relations sont très variables. Il y a un côté rapport de force quand on contacte par exemple le service de communication d’un hôpital qui est mis en cause pour une erreur médicale. À l’inverse, on peut parler de travail d’équipe, même si je n’aime pas ce terme, quand on va sortir en exclu les résultats d’une grande étude incroyable faite par cinq chercheurs de l’Institut Pasteur depuis dix ans dans le monde. Mais ce n’est pas un partenariat car c’est l’article du Parisien : l’Institut Pasteur n’a pas son mot à dire dessus.
Je peux dire qu’on travaille ensemble, mais de là à dire qu’on avance main dans la main, non.
Qu'est-ce que vous attendez d'un CP ? Quelles sont les erreurs à éviter ?
Il y a plein d’erreurs à éviter. Je me méfie généralement des mails annonçant une nouvelle révolutionnaire censée tout bouleverser, d’autant plus lorsqu’ils commencent par des majuscules. Les mails sont surement écrits de cette façon pour chercher un effet percutant, mais il ne faut pas chercher à en faire trop. Je me dis que si c’était vraiment incroyable, l’information aurait déjà circulé autrement ou aurait été reprise par d’autres médias.
Également, les mails qui commencent par un autre prénom partent directement dans ma corbeille. Cela donne l’impression d'un envoi automatisé adressé à 30 000 journalistes. Un envoi ciblé à quelques personnes est toujours plus pertinent et percutant.
Par ailleurs, je me méfie des études commandées par des labos. Peu importe la méthodo utilisée, il y a toujours quelque chose derrière, par exemple un produit à vendre.
Il y a aussi les journées mondiales. C’est un peu ma hantise, car en santé, il y en a quasiment tous les jours : journée mondiale du cancer chez les enfants, journée mondiale du don d’organes, etc. Ça m’arrive de faire un sujet anglé à l’occasion d’une journée thématique mais c’est très rare. J’ai l’impression que c’est la facilité. Mais je sais que les communicants sont très tentés de nous proposer des sujets liés à ces évènements.
En résumé, à la lecture d’un CP, j’aime bien accéder à l’information brute très vite. J’ai besoin que ce soit clair : quelle est la nouveauté ? Pourquoi elle peut avoir du sens ? Pourquoi elle peut intéresser Le Parisien ? Et surtout comment s'ancre-t-elle dans l’actualité ? Pourquoi est-ce que c'est un sujet maintenant et que ce n’était pas le cas il y a deux mois ?
En résumé, quelles sont les conditions pour de bonnes RP ?
La franchise. Je préfère que le communicant assume avoir envoyé son mail à une dizaine de journalistes, plutôt que de laisser croire à chacun qu’il est le seul destinataire. Il faut dire s'il y a un embargo ou pas, et ne pas promettre une exclu si ce n’est pas le cas.
La franchise vaut aussi pour moi. Peut-être que parfois je devrais être plus franc lorsqu’un sujet ne m’intéresse pas.
Également, lorsque j’exprime un désintérêt, j’attends des communicants qu’ils respectent cette position, sans insister.
Voilà ce que je retiens pour poser les bases d’une relation professionnelle claire entre journalistes et communicants.
Les attentes de Nicolas Berrod :
- Une info claire, rapidement identifiable
- Un lien avec l’actualité, pas un prétexte
- De la franchise, pas des effets d’annonce
- Pas de mail générique envoyé à des milliers de journalistes
Propos recueillis par Madeline Humbert