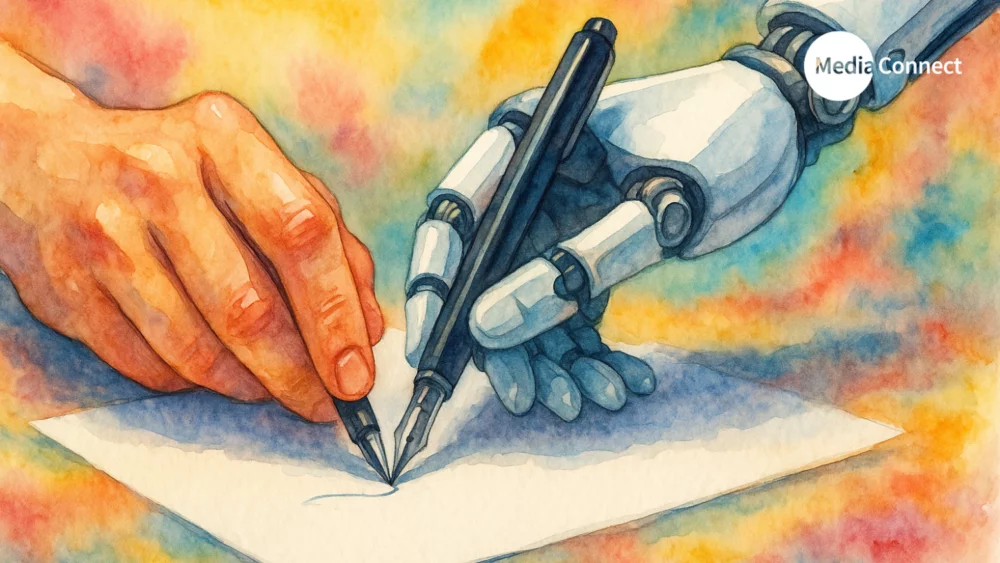Vous avez cofondé Le 1 en 2014, quel bilan tirez-vous de ces dix années écoulées ?
Un bilan assez joyeux ! Il y a 10 ans, nous ne souhaitions pas créer un journal de plus mais faire une proposition différente, en créant un véritable objet de presse, avec un triple geste, journalistique bien sûr, mais aussi littéraire et artistique. Le constat de l’époque – qui est encore vrai aujourd’hui – est que nous étions dans un mouvement de dématérialisation et de miniaturisation des supports. Un journal était quelque chose que l’on allait lire puis jeter, alors que nous voulions nous inscrire dans une vision durable de l’information. Nous traitons ce qui est actuel sans parler d’ « actualité », qui parfois nous éblouit, alors qu’elle n’est pas nécessairement ce qu’il y a de plus important.
Vous traitez effectivement un seul thème par semaine. Quelle fut la genèse de cette idée ?
Juste avant que je prenne la direction du Monde en 2007 et après une énième crise interne, nous avions créé avec des collègues une petite équipe afin d’étudier ce que l’on produisait. C’était en 2004, dans une période où le numérique commençait à prendre une part très importante. Nous nous sommes rendu compte que nous écrivions sur trop de choses, sans en parler nécessairement bien. En arrivant à la tête de la rédaction, j’ai simplifié la Une en prenant le parti de ne pas tout évoquer. Si l’on vous lance un ballon, vous allez l’attraper. Si l’on vous en lance trois, vous allez tout laisser tomber par terre. C’est aussi simple que cela, il fallait choisir, organiser le « ratage ».
Diriez-vous qu’aujourd’hui, Le 1 est parvenu à trouver son public ?
Nous comptons en moyenne 19 000 à 20000 abonnés, auxquels s’ajoutent 10 000 à 15 000 acheteurs en kiosques. Chaque semaine, ce sont donc 33 000 à 35 000 personnes qui, via différents canaux, nous sont fidèles. Il y a également un chainage de générations, avec des jeunes et des moins jeunes qui lisent Le 1. Je dis en souriant que notre plus vieil abonné a 103 ans, car il s’agit du philosophe Edgar Morin, qui m’a encore la semaine dernière réclamé son abonnement ! Quand je regarde par le hublot, je suis inquiet, car la mer est démontée, mais dans cette tempête, nous parvenons à hisser notre pavillon. De manière assez modeste, car nous sommes un petit journal, mais nous instillons une manière de regarder le monde un peu différente, que recherchent ceux qui nous lisent.
Comment expliquez-vous que Le 1 soit parvenu à survivre dans cette verticale du journalisme qui prend son temps, où tant d’autres ont échoué ?
Je me souviens de cette phrase de Colette : « Avec les mots de tout le monde, écrire comme personne ». Avec les mêmes outils que les autres, nous avons créé quelque chose de différent. Il est vrai qu’il y a une dimension ludique au dépliage de notre journal, l’envie de savoir ce qui se trouve sur le pli d’après. Et puis nous avons donné l’idée qu’un hebdomadaire pouvait être un objet artistique. Ce n’est pas pour rien que des artistes tels que Fabienne Verdier, Gérard Fromanger, Pénélope Bagieu et tant d’autres, ont beaucoup aimé collaborer avec nous. Je pense que notre proposition est un geste de rupture, assez radical. A mes yeux, beaucoup de médias disparaissent car ils ne se différencient pas. Un journal doit être comme un artiste, il doit se singulariser.
Et puis, nous sommes un journal de l’offre, nous proposons des sujets qui nous plaisent. Les thèmes qui rencontrent le plus leur public sont les thèmes historiques, mais aussi ceux qui portent sur des événements comme les guerres, les attentats, car les lecteurs ont alors une forte envie de comprendre.
Lorsque vous regardez en arrière, y a-t-il eu des moments difficiles ? Avez-vous parfois craint de devoir fermer boutique ?
Tout d’abord, chaque année, il disparaît entre 800 et 1000 kiosques. Etant donné que nous nous appuyons aussi sur ces points de vente, c’est une contrainte à laquelle nous sommes confrontés.
Mais la vraie inquiétude a eu lieu au moment de la guerre en Ukraine, lorsqu’une tonne de papier est passée de 300 à 900 euros. C’est clair qu’il est plus complexe d’être un journal papier. Le tout-numérique supprime trois coûts : celui du papier, de l’impression et de la distribution. Donc nous avons augmenté les prix, mais nous n’avons pas pu les répercuter de manière proportionnelle à l’augmentation des coûts.
En plus du 1, vous avez également créé d’autres revues, telles que Zadig, Légende ou America. Dans quel but ?
C’était intéressant d’appliquer l’état d’esprit et l’approche du 1 à d’autres univers. Cela a commencé avec America. Lorsque Donald Trump a été élu en 2016, nous avons eu l’idée, avec le critique littéraire François Busnel, de réunir les plus grands reporters, écrivains, artistes et intellectuels des Etats-Unis, dans un trimestriel de 200 pages, afin qu’ils expriment leur vision de l’Amérique. Nous l’avons édité pendant quatre ans et nous avons récolté ainsi de nombreux lecteurs.
Nous avons ensuite voulu dupliquer cela pour la France, et c’est ainsi qu’est né Zadig, que nous avons édité pendant cinq ans et demi et qui comportait également beaucoup de reportages.
Légende est la fin de notre triptyque. Nous avons d’un côté, les idées avec Le 1, de l’autre, le terrain avec Zadig et America. Légende, en racontant la vie de ces personnalités dont la vie n’était ni si parfaite ni vertueuse, nous a permis d’accéder à l’incarnation. Lors d’un entretien avec Michel Serres, il m’avait dit que nous étions dans une période de dénigrement et que pour construire, il fallait pouvoir admirer. C'est ainsi que tous nos titres se tiennent par la main, d’une certaine manière.
En lançant ces différents formats, n'y avait-il pas une question plus pragmatique : celle de diversifier vos revenus ?
Sans doute. Et puis cela nous permet de toucher de nouveaux publics. Je suis aussi chef d’entreprise et la diversification des revenus est effectivement une question importante. Mais elle s’est d’abord faite à travers les déclinaisons du 1. Nous avons d’ailleurs vendu notre licence et notre savoir-faire au journal italien La Stampa, qui a fait Le 1 durant quatre années ; cela s’appelait L’origami. Puis nous avons créé Le 1 XS – un format livre de poche pour les libraires, qui fonctionne très bien -, puis Le 1 XL, qui comporte de grandes affiches.
Nous avons également fait le pari de ne pas dépendre de la publicité. Cela nous force à être inventifs et à imaginer des relations avec des partenaires qui ne soient pas que des relations commerciales. Avec des institutions culturelles par exemple.
Pour finir, voyez-vous le « slow journalisme » s’imposer dans une ère où tout s’accélère ?
Je n’aime pas vraiment l’appellation de « slow journalisme » car nous n’avons pas consciemment voulu en faire et une étiquette peut vite nous enfermer. Mais nous sommes sans doute tel Monsieur Jourdain, qui fait de la prose sans le savoir ! Pour revenir à votre question, je suis convaincu qu’il y a souvent, dans les moments historiques d’évolution technique, un mouvement de balancier. Je crois que cette appétence d’un public pour une lecture longue et lente est sous-jacente et devient le remède et l’antidote à l’excès inverse. Je pense que le succès des revues comme Le Grand Continent ou comme la nôtre, témoigne d’un besoin informulé de cesser ce défilé d’images et d’opinions exprimées partout, tout le temps, et qui finissent par nous donner le tournis.
Propos recueillis par Cléophée Baylaucq.