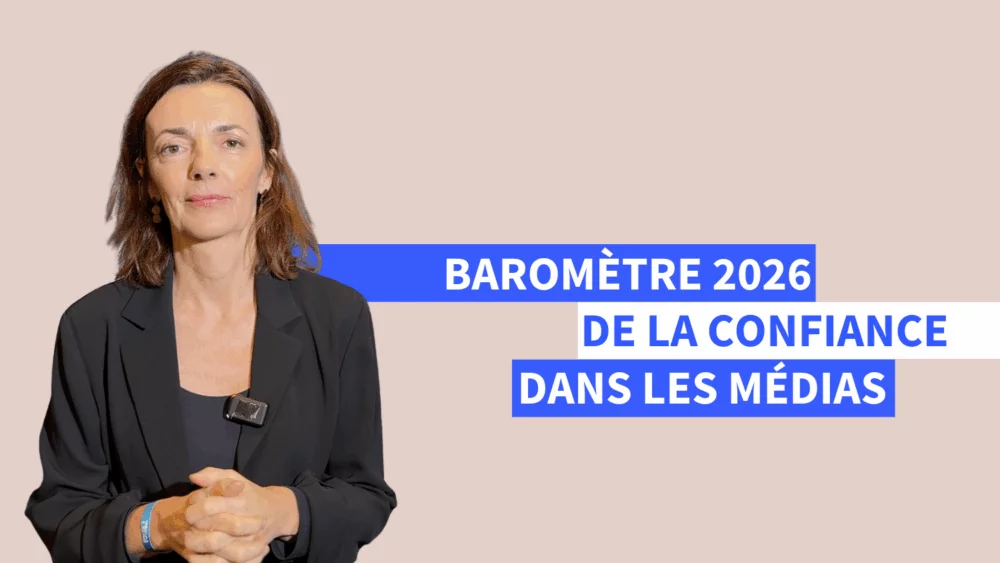Certains opposent la communication privée à la communication publique. Au cours de votre parcours, vous avez expérimenté les deux. Qu’en pensez-vous ?
Je pense que les fondamentaux du métier restent les mêmes. Dans les deux cas, nous utilisons des outils de communication puissants, au service de la stratégie de notre entité et nous mesurons le résultat de nos actions avec une constante : l’exigence d’efficacité. Les techniques sont similaires, même si elles servent des finalités et parfois des cibles différentes.
Dans le secteur privé, la communication répond principalement à des enjeux business. Toute entreprise proposant un produit ou un service doit orienter ses messages vers les publics susceptibles d’y trouver un intérêt.
En revanche, dans la sphère publique, l’objectif est autre : il s’agit principalement d’informer, d’expliquer les droits et dispositifs accessibles, de créer de la confiance. La communication publique touche tous les citoyens, ce qui implique d’utiliser des canaux assez larges et de veiller à ce que le message parvienne même à ceux qui s’estiment moins concernés ou qui sont plus éloignés des canaux traditionnels.
Selon vous, le secteur public impose-t-il des exigences particulières, en particulier en matière de RP ?
Pour moi, tous les communicants partagent un même souci d’efficacité mesurée par des indicateurs de performance (KPI).
Concernant les relations avec les journalistes, la sphère publique, traite de questions d’intérêt général qui génèrent de très fortes attentes en matière de transparence. Par essence, les services publics sont financés par les Français. L’un des devoirs de la communication réside donc dans la nécessité de « rendre compte », avec honnêteté, quitte à reconnaitre ses erreurs lorsque c’est nécessaire.
Dans l’exercice des relations presse, il faut donc à la fois être capable de nourrir le débat auprès des journalistes hyper spécialisés, mais aussi de faire un véritable travail de pédagogie avec ceux plutôt généralistes. Nous n’avons pas (vraiment) le droit à l’erreur, et la crise est vite arrivée. Et si c’est le cas, d’un point de vue communication, vous devez être réactif, répondre aux interpellations, expliquer, assumer vos responsabilités.
Justement, dans un contexte d’instabilité politique, comment maintenir une continuité dans la communication ? Comment restaurer la crédibilité de la parole publique ?
Il est essentiel de rester très factuel, de ne pas se cacher, ne pas conjecturer et dire les choses telles qu’elles sont.
La crédibilité de la parole publique repose sur la transparence, l’éthique, l’honnêteté vis-à-vis des publics. Pour être très concrète, il est indispensable d’utiliser des mots simples, accessibles pour rendre le message compréhensible par tous. Au-delà de notre rôle de communication, nous avons un devoir d’information. Nos actions doivent se lire au prisme de leur utilité vis-à-vis du public. Pour se réconcilier avec les citoyens, il faut être pragmatique, simple, éviter les termes trop techniques, répondre aux véritables questions du public. L’exercice qui consisterait à « placer son message », « ses éléments de langage », montre vite ses limites.
Dans quelle mesure le cadre du service public pose-t-il des contraintes spécifiques à l’exercice de vos missions quotidiennes ?
De mon expérience, l’une des complexités dans le secteur public concerne les achats. Le travail administratif autour des marchés publics est assez lourd, contraignant et chronophage. Mais c’est la règle et nous la connaissons ; nous nous y soumettons.
Certains interrogent la rapidité des prises de décision. Pour moi, elle ne dépend pas du secteur. Peu importe : que vous travailliez dans le public ou le privé, votre capacité à déployer une assertivité suffisante pour convaincre votre hiérarchie ou votre tutelle fera la différence.
Quels sont selon vous les plus grands défis actuels et à venir pour les communicants du secteur public ? Comment s’adapter aux évolutions ?
Le défi commun à l’ensemble des professionnels de la communication consiste à expliquer notre métier, son utilité, sa technicité. Il y a parfois une certaine défiance vis-à-vis de la communication. Nous devons prouver en permanence que communiquer représente un investissement et non une dépense inutile. Dans une période où l’Etat cherche à faire des économies, les mesures d’optimisation des dépenses de communication sont légitimes. Nous devons participer à l’effort collectif. Pour autant, cela ne nous empêche pas de démontrer notre utilité. Au risque de me répéter, c’est pour cette raison que nos actions doivent être mesurées.
S’adapter aux évolutions constantes constitue également un véritable enjeu pour les communicants. Cela implique de se professionnaliser en permanence et de se former à l’utilisation des nouveaux outils. On entend beaucoup parler de l’intelligence artificielle comme un concurrent à nos métiers. Je crois qu’il faut surtout s’en emparer intelligemment, par exemple pour rédiger des communiqués de presse, ou faire de la veille. Refuser d’utiliser les outils d’IA, c’est comme refuser Internet il y a quelques années : c’est absurde.
Enfin, la désinformation s’impose aujourd’hui comme l’un de nos plus grands défis, que nous partageons avec les médias. Pour moi, les communicants publics ont un vrai rôle à jouer, dans la mesure où cet engagement est inhérent à leurs missions de pédagogie et d’information. Des personnalités comme Olivia Pénichou, la déléguée à l’information et à la communication de la Défense, Carine Delrieu, Dircom de l’INSERM ou encore Fabrice Hermel, directeur de la communication de la Banque de France pour ne citer qu’eux ont des démarches très avancées en matière de lutte contre les fake-news vis-à-vis de l’ensemble de leurs parties prenantes, y compris internes. C’est une tendance que j’observe de plus en plus chez nos adhérents, chacun sur leur thématique.
Quels sont les autres grands enjeux de la communication publique, sa raison d’être selon vous ? Comment se traduit-elle à travers les relations presse ?
La communication publique a pour mission première de servir l’intérêt général, en mettant la transparence, la pédagogie et la proximité au cœur de ses actions. Elle vise à renforcer le lien de confiance entre les institutions et les citoyens : elle informe, explique les politiques publiques, rend compréhensibles les dispositifs et favorise le débat démocratique. Les médias sont de formidables relais pour porter ces enjeux.
A lire aussi :
- Fake news : le nouveau risque stratégique pour les entreprises
- GEO et RP : quelle stratégie pour être visible sur les moteurs IA ?
- Héloïse Guillet (Be RP) : « L’IA est un outil, pas une baguette magique »
- Comment bien mesurer et analyser les retombées presse ?