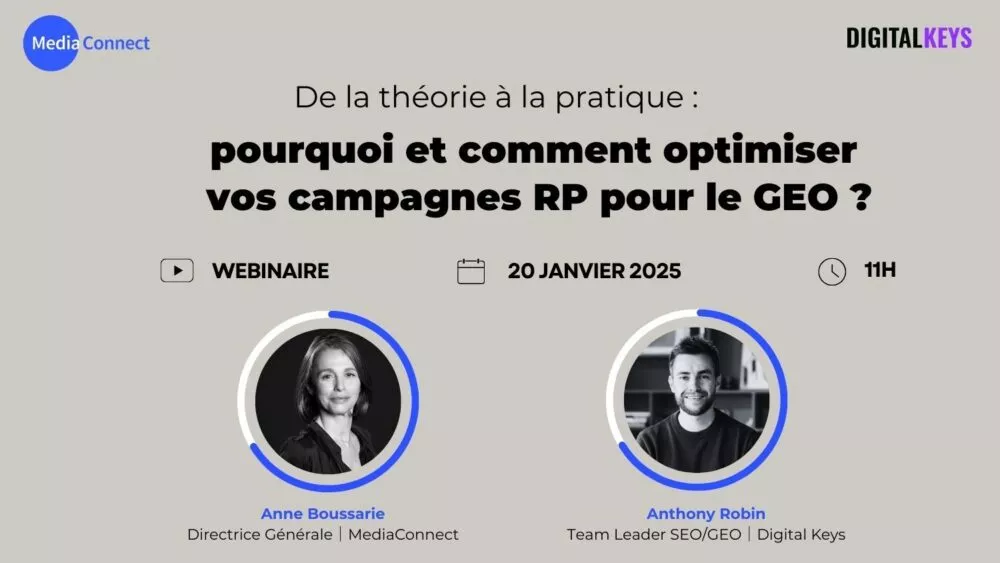Quelles différences ?
La désinformation est sans doute la plus connue. Elle désigne une information délibérément fabriquée avec l’intention de tromper. « La combinaison d’un contenu faux et d’une volonté manifeste de manipulation », résume Arnaud Mercier, directeur de la licence numérique Information-communication à l’Université Panthéon-Assas. Ces dernières sont « attribuées à une institution, un parti politique ou un pays, souvent avec des intentions économiques ou politiques », ajoute Manon Berriche. Une manipulation d’autant plus redoutable, qu’elle est devenue capable d’imiter les codes de la presse, comme en témoigne l’opération Doppelgänger : campagne de désinformation menée depuis le début de la guerre par l’agence russe, Social Design Agency (SDA) ayant usurpé l’identité de médias européens pour propager des narratifs favorables au Kremlin.
La malinformation, elle, repose sur des faits réels, mais détournés de leur contexte dans le but de nuire à une personne, une organisation ou un pays. À l’image du meurtre en 2022 de l’adolescente Lola, « largement récupéré par des figures de l’extrême droite afin de renforcer leurs programmes politiques », observe Manon Berriche.
Mais les définitions varient. Arnaud Mercier s’appuie sur les travaux de François Heinderyckx, professeur de journalisme à l’Université Libre de Bruxelles, pour définir la malinformation autrement : « des informations qui ne sont pas volontairement faussées, mais qui résultent d'un mauvais traitement de l'information, en raison du non-respect des principes de base du journalisme. » Par exemple, lorsque plusieurs médias ont annoncé à tort en 2019 que Xavier Dupont de Ligonnès avait été retrouvé en Écosse.
Enfin, la mésinformation correspond à la diffusion d’informations fausses ou mal établies, mais sans intention malveillante. « Souvent sur la base d'un excès de confiance ou d'une réaction émotionnelle », estime Arnaud Mercier, également coordinateur de DE FACTO, projet européen de lutte contre la désinformation. Plus courante, notamment sur des sujets de santé ou scientifiques, « la mésinformation se différencie de la rumeur, par son caractère factuellement faux », insiste Manon Berriche. « Pensant bien faire, certains peuvent partager un remède prétendument efficace, même si le consensus scientifique le dément », conclut l’enseignante.
Comment caractériser l’intention ?
Lors de l’apparition du terme fake news en 2016, la focalisation se portait davantage sur la mésinformation et la désinformation, « sans se concentrer sur l'instrumentalisation de vraies informations et de leurs mises à l'agenda », se désole Manon Berriche.
Alors, pour tenter d’identifier l’intention derrière la diffusion de fausses informations, plusieurs éléments sont pris en compte. D’abord, le profil du locuteur. « Lorsqu’un élu relaie une fausse information sur X, nous connaissons sa position politique, ce qui permet d'émettre des hypothèses sur son intention », relève Manon Berriche. « L’analyse réputationnelle d’acteurs ayant déjà relayé de fausses informations, ou à l’inverse, bénéficiant d’une grande crédibilité fournit également des indices », ajoute Arnaud Mercier.
Autre critère : la reconnaissance de l’erreur. « Un désinformateur ne s'excuse jamais. Il nie et se réfugie dans une réalité alternative lorsqu’il est pris la main dans le sac », poursuit Arnaud Mercier. « Lors de la supposée découverte de Xavier Dupont de Ligonnès, tous les médias ont reconnu leur erreur et se sont excusés. » Mais parfois « les lignes éditoriales sensationnalistes laissent penser à des motivations économiques », et il arrive que des médias diffusent volontairement des informations mal établies « pour chercher à générer du clic », avertit Manon Berriche.
La virulence du message est également un indice. « Des éléments dégradants ou agressifs, peuvent révéler une volonté de régler un compte », juge Arnaud Mercier. « Cela devient plus difficile si l'on s'intéresse au public en général. Même s’il peut y avoir des indices de politisation, il est assez complexe de connaître l'intention d'un internaute ordinaire », nuance Manon Berriche.
Quels impacts sur la société ?
« Les effets sont très difficiles à mesurer. Une personne peut se montrer sceptique à l’égard des vaccins tout en choisissant quand même de se faire vacciner, ou au contraire, être favorable à une personnalité, mais décider de ne pas voter pour elle », relève la chercheuse. « Il est difficile de supposer qu'une simple exposition à un seul contenu pourrait transformer radicalement l'opinion d'un individu, il s’agit plutôt d’une exposition répétée dans un certain environnement social. »
Si les effets de la désinformation restent difficiles à isoler, certains cas sont documentés. « Nous savons que la désinformation sur Facebook a incité à des violences contre la population rohingyas », rappelle ainsi Arnaud Mercier. Pour Manon Berriche, ces troubles de l’information brouillent le débat public : « Quand des acteurs avec une grande visibilité ou responsabilité propagent massivement des infox, ils imposent un cadre faussé. »
Quelles solutions ?
« Les journalistes vérifient les faits et les transmettent ensuite aux citoyens grâce au fact-checking », rappelle Arnaud Mercier. Mais son efficacité varie selon les publics, avertit Manon Berriche : « certains s’inquiètent de son effet rebond. » Par exemple, un fact-check sur l'intérêt de la vaccination, « pourrait renforcer l'opinion de certains lecteurs contre les vaccins en provoquant chez eux une réaction de rejet. Même si ce n’est pas systématique. »
Dans un contexte où diffuser des éléments d’information est à la portée de tous, Arnaud Mercier conseille « d’adopter des réflexes qui ressemblent à ceux des journalistes » et encourage « les internautes à pratiquer l'OSINT (Renseignement d'origine sources ouvertes) et faire ainsi du fact-checking à leur manière. »
Enfin, s’appuyer sur les institutions et initiatives dédiées à l’éducation aux médias, « comme le CLEMI ou l’association Square, qui organise des interventions dans les collèges et les lycées, un travail nécessaire », suggère Manon Berriche.
Selon Arnaud Mercier, il est par ailleurs essentiel de « former au débiaisement, pour lutter contre le biais de confirmation, l’un des biais cognitifs majeurs. » Et de préciser : « Il ne faut pas non plus oublier qu’une part du public est influencée, car elle le veut bien ! Non pas par ignorance, mais parce qu’elle adhère consciemment à certaines croyances, parfois alimentées par une défiance envers les médias traditionnels. »